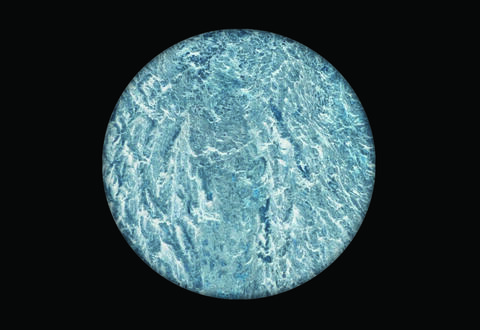![Fig. [01], La déroute 1990.](/sites/default/files/styles/programmation_top_tile/public/programmations/17063/image/laderoute1080x19201.png?itok=U2VSIAj-)
Carte blanche à Panorama-cinéma — Après le désert
Après le désert est une programmation de Samy Benammar créée dans le cadre de l'invitation de Vidéographe lancée à l'équipe de la revue Panorama-cinéma.
Samy Benammar est un artiste et critique de cinéma résidant à Montréal. Son travail d’écriture et de réalisation se pense comme une expérimentation autour d’enjeux sociopolitiques hérités de ses origines algériennes et ouvrières. Il a notamment réalisé Avant Seriana (2024), kaua’i’o’o (2023), Peugeot pulmonaire (2021). Ses films, présentés dans des festivals au Canada et à l'international, sont distribués par Winnipeg Film Group, Vidéographe et CFMDC. Il est membre du comité de rédaction des revues 24 images et Panorama-cinéma.
Liste des œuvres au programme
Peut-on faire le vide ? J’aimerais poser cette question à un personnage d’hypnotiseur dans un film un peu kitsch des années 1990. L’équipe technique se précipiterait sur le tournage, la caméra effectuerait un zoom arrière, révélant un studio hollywoodien au bord de la faillite. Voyant les visages se décomposer, tous pris dans une crise existentielle provoquée par mon intervention pourtant anodine, je finirais par rompre le silence : « les marchands de vide, c’est nous ». Plus tard, un podcast de méditation me murmure : « Fermez les yeux, détendez-vous et relâchez tous vos muscles. Faites le vide et imaginez-vous dans le désert. ». Mais le désert est loin du vide puisqu’il a cette propriété troublante de ne pas connaitre de fin perceptible. C’est la tension centrale de la notion de vide puisque l’absence de tout qu’elle implique constitue une forme d’invitation à remplir, à se remplir. Plutôt que de craindre cet état, pourquoi ne pas en faire une énergie libératrice, cet éternel recommencement auquel les films de ce programme proposent de réfléchir ? « Inspirez, expirez, ressentez la plénitude. »
Il s’agit moins d’apprendre à faire le vide que de savoir quoi en faire. Inutile de développer les implications politiques d’un tel constat qui résulte d’un sentiment d’impuissance cristallisé par l’escalade de violences sur la scène internationale dans la dernière année. Les images du programme Après le désert naissent alors que le monde a déjà pris fin. Il ne reste rien et c’est avec ce rien qu’il leur faut conjuguer. Au terme du trajet, émergera peut-être la possibilité de réhabiter le désert et sa virginité initiale se révèlera être une invitation à n’avoir de limite que les corps qui y résident.
Cette entrée en matière est quelque peu brumeuse, elle essaye de déterminer un point de départ en respectant l’idée de dérive inhérente à l’imaginaire désertique. Peut-être aussi parce que regarder vers le désert, c’est tourner le dos à la mer et à la montagne et ainsi embrasser pleinement l’invitation de Belmondo à aller nous faire foutre.
Vers le désert
L’évier est rempli d’une eau savonneuse dans laquelle les mains plongent pour laver une à une les tasses. Toujours dans le même ordre : saisir, frotter, rincer, reposer. Toujours les mêmes sensations : céramique, mousse, torrent, torchon. La répétition introduit l’évasion alors qu’à la banalité quotidienne de cette première scène de Sirensong (Jan Peacock, 1984), succèdent des vagues qui nous signalent une fuite de la pensée. La répétitivité de la tâche ouvre la possibilité à une voix intérieure de retracer un chemin entre l’intime et le politique. « Maybe it was twelve or maybe I was twelve » dit-elle, pour introduire le souvenir des titubements impérialistes de Neil Armstong retransmis sur l’unique téléviseur de l’école. S’y déploie la vieille question de la mémoire que Duras commentait si joliment dans L’amant : « l’histoire de ma vie n’existe pas, [il n’y a que] de vastes endroits où l'on fait croire qu'il y avait quelqu'un ». En commentant les minutes précédant l’alunissage sur le mode du futur antérieur, Peacock ajoute une nuance à l’idée du souvenir comme matière émergeant du vide laissé par le passé : « Someone says “A man is going to walk on the moon. A man is going to walk on the moon” and you don’t wait to see it, you see it right away in your head. Like an image projected on the lens, like the figures on the tv screen with only the sound of their own alluring breath, Siren Voiced. ». L’évènement s’accompagne d’une absence doublement investie : par ce que nous en avons imaginé et par ce que nous nous y remémorons.
Un phantom ride nous fait glisser vers Monument Valley avec la perturbante douceur de cette technique prise entre l’incarnation d’un regard-mouvement et le flottement spectral initié par la translation trop régulière du véhicule. Visuellement et conceptuellement, nous approchons du désert par une expérience hallucinatoire indissociable du caractère surréel de ce paysage et de son omniprésence dans l’imaginaire collectif. « Like the vacation landscapes you’ve seen a hundred times, in postcards, in mainstream movies, in National Geographic, in tv commercials ». Dans son texte (IN)SCRIPT, Jan Peacock explique que la réalisation a été ponctuée d’échecs de la vision résultant d’une résistance du désert à être filmé. Ses premières images vidéo réduisaient le gigantisme du Grand Canyon à un aplat bidimensionnel, l’amenant à conclure « though one could still recognize the Grand Canyon, one could not see it. ». L’enjeu de l’incommunicabilité de l’expérience du désert réside dans le paradoxe d’un espace défini par sa capacité à nous confronter sensoriellement au vide et l’importance de ne pas subordonner une réalité physique à notre perception de celle-ci. D’autant plus lorsque l’espace en question est indétachable d’enjeux coloniaux, et ce de l’Arizona au Sahara.
Pour répondre à ce réseau complexe - imaginaire collectif et expérience individuelle, vide et surcharge sensorielle, mémoire et anticipation -, le programme pense le désert comme l’expérience d’un corps transfiguré : « You are lured into seeing the place, except it’s no longer a place. It’s a scene, a point of interest. You are in it and apart from it. Inside every image of it. Imagine your presence here. It’s a landscape of association and you map yourself into that. »
Corps de sable
Force est de constater un autre paradoxe, ma tentative maladroite de discuter de corporalité par un texte dont la logique discursive frôle dangereusement l’obscurantisme conceptuel. Brisons-le franchement, quitte à perdre toute cohérence en abordant naïvement et factuellement le deuxième film du programme ; c’est, après tout, ce qui m’intéresse dans le désert autant que dans le geste de programmation : il réunit et divise, confronte une série de visions en essayant d’établir un équilibre entre la ressemblance et la différence. Les images de Corps d’œuvre (1988) peuvent être classées en trois catégories.
Les premières présentent une femme, Lynda Gaudreau oscillant entre mobilité et inertie dans un paysage aride. Là elle se frotte le long d’une paroi, ses muscles répondant aux inflexions de la roche. Ici, un ralenti accentue le déploiement de son corps qui saute sur place, s’éloignant et se rapprochant du sol, comme pour vérifier sa présence par percussion. Dans une sorte d’ode à sa propre animalité, la figure entre dans un jeu d’apprivoisement, d’acceptation et de rejet : elle rampe, marche à quatre pattes, roule, se redresse et s’effondre. Elle s’inscrit dans le désert.
Ensuite, des arrêts sur image transforment le corps en surface de projection où apparaissent des tableaux et des textures rocheuses. Le désert s’inscrit dans le corps et y surimprime le traumatisme d’un déchirement : celui de l’être humain à son propre état de nature. C’est moins la citation de Della Francesca ou d’autres grands maîtres qui produit cet effet que le rappel de la candeur avec laquelle leurs œuvres s’adressaient au monde. On voit, dans le corps de Lynda Gaudreau, un regard inquiet à la peinture craquelée, un blessé soutenu par son frère puis un rapport sexuel entre une louve et une femme.
Enfin, des dessins enfantins, au style vaguement inspiré de Douanier Rousseau, sont incrustés dans des plans fixes, nous ramenant à une certaine insouciance au sein de l’environnement pour le reste assez inquiétant du film. L’expérience corporelle matérialisée dans le film de Chantal duPont est une inscription réciproque (l’un dans l’autre, l’autre dans l’un) nous replongeant dans une question préalablement effleurée : qu’inscrit-on dans le vide ?
Conjuguer avec le rien
Je crains les images qui connectent l’environnement à un corps. Bien qu’essentielles, elles présentent le risque de s’approprier l’espace. Impossible pour moi de penser au désert sans que me reviennent en mémoire les récits d’amis et avec eux, de centaines d’autres, pour qui cet espace est avant tout une fuite vers et contre une frontière. Mes craintes à moi concernent la représentation d’un paysage dont l’imaginaire est la plus grande force mais aussi la menace la plus fondamentale. En mai 2024, « la première image virale générée par l'IA » envahissait les réseaux sociaux. Elle présente un désert s’étendant jusqu’à un horizon de montagnes enneigées. Des tentes rangées orthogonalement y actualisent une vision fantasmée d’un camp de réfugiés. Au centre, d’autres tentes, blanches et plus volumineuses, forment les lettres du slogan All eyes on Rafah. En choisissant le désert comme « thématique » pour cette programmation, je marche au bord du précipice, conscient que les deux premières œuvres proposées participent d’une esthétisation à travers un regard blanc auquel on pourrait reprocher de négliger les tensions de ces territoires dont les grains de sable ont recouvert les litres de sang d’une histoire génocidaire. C’est le double tranchant de la question du rien : considérer le désert comme un espace vide, c’est nier l’historicité de ses implications politiques, mais l’y ramener constamment serait refuser la liberté du rêve permis par une toile que l’on suppose vierge. En découle notre dernière digression sous la forme d’un dialogue entre deux films : Boomerang (2019) de Nayla Dabaji et La Déroute (1990) de Rodrigue Jean.
Le dispositif de Boomerang fait interagir trois éléments : le bord de mer que l’on devine libanais (qu’il le soit ou qu’on essaye de nous y faire croire), des archives de ce même espace (télévision, film de famille, etc.) et un commentaire textuel. Ce dernier s’adresse à un vieil ami et relate des moments passés ensemble qui, comme dans Sirensong, sont pris entre imaginaire et souvenir. Le court-métrage tire son titre d’une performance éponyme de Nancy Holt & Richard Serra datant de 1974. Holt y lit un texte qui lui est retransmis avec un délai électronique par un casque audio. Sa récitation est ainsi perturbée par l’expérience d’un passé à court terme auquel elle doit résister pour maintenir son débit de parole. « I have the feeling that I’m not where I am, I feel that this place is removed from reality », dit-elle, engageant un rapport au territoire déterminant dans les récits libanais qui intéressent Nayla Dabaji. L’exemple le plus emblématique est certainement Il était une fois Beyrouth (1994) de Jocelyne Saab où deux jeunes femmes découvrent l’histoire de leur ville à travers de vieille bobines de films qu’un projectionniste les invite à visionner dans son cinéma. En ancrant les considérations énoncées jusqu’à présent dans un espace politiquement chargé, Boomerang fait vaciller notre définition du désert comme espace immobile et agglomérat d’imaginaires. Que devient l’espace quand notre expérience et notre corporalité sont entièrement construits dans un rapport médiatisé, quand la mémoire individuelle se confond avec les traces technologiques ? Nayla Dabaji incruste les archives par un surcadrage numérique sur le bord de mer. Les deux images sont ainsi superposées de manière à problématiser la hiérarchie entre les deux régimes visuels. D’une part, l’archive agit comme une obturation, elle dicte une direction, d’autre part le paysage devient l’environnement d’émergence qui englobe l’archive. De ce fait, chacune des images est subordonnée à l’autre, mais c’est ce statut de décor qui permet l’invocation de son contre-champ.
Le vent et les grésillements médiatiques produisent une piste sonore écrasante et les mots décrivent un espace prisonnier d’une histoire ayant déjà eu lieu sans que ses acteurs ne puissent y changer quoi que ce soit. On y lit successivement : « Il n’y a pas de temps les aiguilles ne tournent pas et c’est une perte de temps », ou encore « Tu te rappelles la soirée où on anticipait le bruit des feux d’artifice en les voyant à l’écran. » Dans l’une des dernières séquences, montée en une indiscernable boucle, une figure à l’arrière-plan est prise dans une marche perpétuelle. La parole, le désert et le Liban se figent au bord de la mer et le corps s’y empêtre. La Déroute de Rodrigue Jean agit alors comme une suite de variations sur l’effondrement. Réalisé alors que le cinéaste était directeur d’une compagnie de danse à la fin des années 1980, le film nous projette sur une plage du Nouveau Brunswick. La parole a disparu, comme si tout ceci se passait au lendemain du langage, dans un pays qui ressemble étrangement à celui décrit par Nayla Dabaji : « Chez moi n’est pas une nation / Chez moi il n’y a pas de guerre / Chez moi c’est l’anarchie ».
Trois danseurs s’alignent jusqu’à n’en faire qu’un dans l’angle de la caméra, mais dès que l’un d’entre eux se penche, tous les autres doivent suivre, résister à son mouvement pour que leurs amplitudes combinées nous ramènent à l’état d’équilibre. Une douceur brutale anime la troupe qu’on dirait constituée des derniers survivants de ce monde redevenu noir et blanc. Dans la mélancolie anarchique de ces pantins imitant le ressac de l’Atlantique, s’insinue un rapport renouvelé au jeu. Une ronde enfantine où chacun pris individuellement résiste à sa propre chute mais où la conjugaison de leurs effondrements les transfigure en une farandole presque légère.
Ce premier court-métrage, tel un envoutement, se joue également des tropes du mélodrame. Le groupe découvre un lieu avant de disparaitre dans sa nuit pour former des couples pris entre amour et séparation jusqu’à l’aube. L’apparition de trois maigres arbres ou d’une série de miroirs réaniment alors leurs carcasses qui étaient aux prises avec le désespoir dans le plan précédent. Bien que la proposition soit plus émotionnelle que symbolique, elle invite à l’interprétation comme savent le faire ces réalisations faites dans l’air d’un certain temps, au gré de quelques hasards et envies. Un vide méditatif apparaît à travers un regard ludique dont l’interaction avec le milieu parvient à osciller entre l’inévitable affaissement qu’impose la violence d’un monde et l’insouciance à la source de toute forme d’espoir. Alors qu’une femme marche sur la rive, les fantômes des amis qui l’accompagnaient juste avant persistent comme s’ils étaient initialement nés de son désir de remplir le vide. C’est vers ce jaillissement, ce rapport primaire d’envie et de jeu, que nous entrainait déjà Jan Peacock : « What you want to conjure for your friend is the thing as you first apprehended it, the sensation remembered from childhood, that moment before words », avant d’ajouter « only the desire to desire ».
Une incantation
Le ciel traversé par des oiseaux est un élément récurrent dans tous les films du programme mentionnés ici. Cet éternel contre-champ au vide laisse deviner que ce dernier consiste moins à faire disparaitre les choses qu’à s’accorder le droit d’en désirer d’autres ; un pouvoir que l’on accorde souvent aux incantations. Dans Chant en 14 temps, l’animation d’Alisi Telengut, peinte à la main, plonge au plus près de la roche, là où sa texture granuleuse redevient ciel ouvert. S’y ajoute la voix de Lamia Yared chantant Omar El Batch. Sa voix joue le rôle d’incantation, réunissant les représentations contradictoires du désert sous l’aile de l’oiseau et nous invitant à considérer la figure du bien-aimé. Je la perçois moins comme un amoureux qu’un miroir, une sorte d’alter ego avec lequel nous traversons les déserts et dont la présence nous permet d’accepter sereinement le vide.
Un rossignol dans le jardin a chanté une chanson (dans le maqam) en Nawa
Il a enchanté à travers le grillage de la cage en chantant le (dans le maqam) Yegah.
Oh cher proche de mon coeur, amène-moi à la rencontre de l'amour
Mon cœur a brûlé
Oh séparateurs de l'amour allez et laissez-moi tranquille puisqu'il n'y a plus d'union avec l'âme sœur.
Le soleil a étincelé la coupe du vin
Lorsque le verseur du vin déposera sa coupe le vin tournera sur lui-même
Et de cette coupe je verrai les traces claires des lèvres posées du bien-aimé.
Omar El Batch, traduit par Lamia Yared.