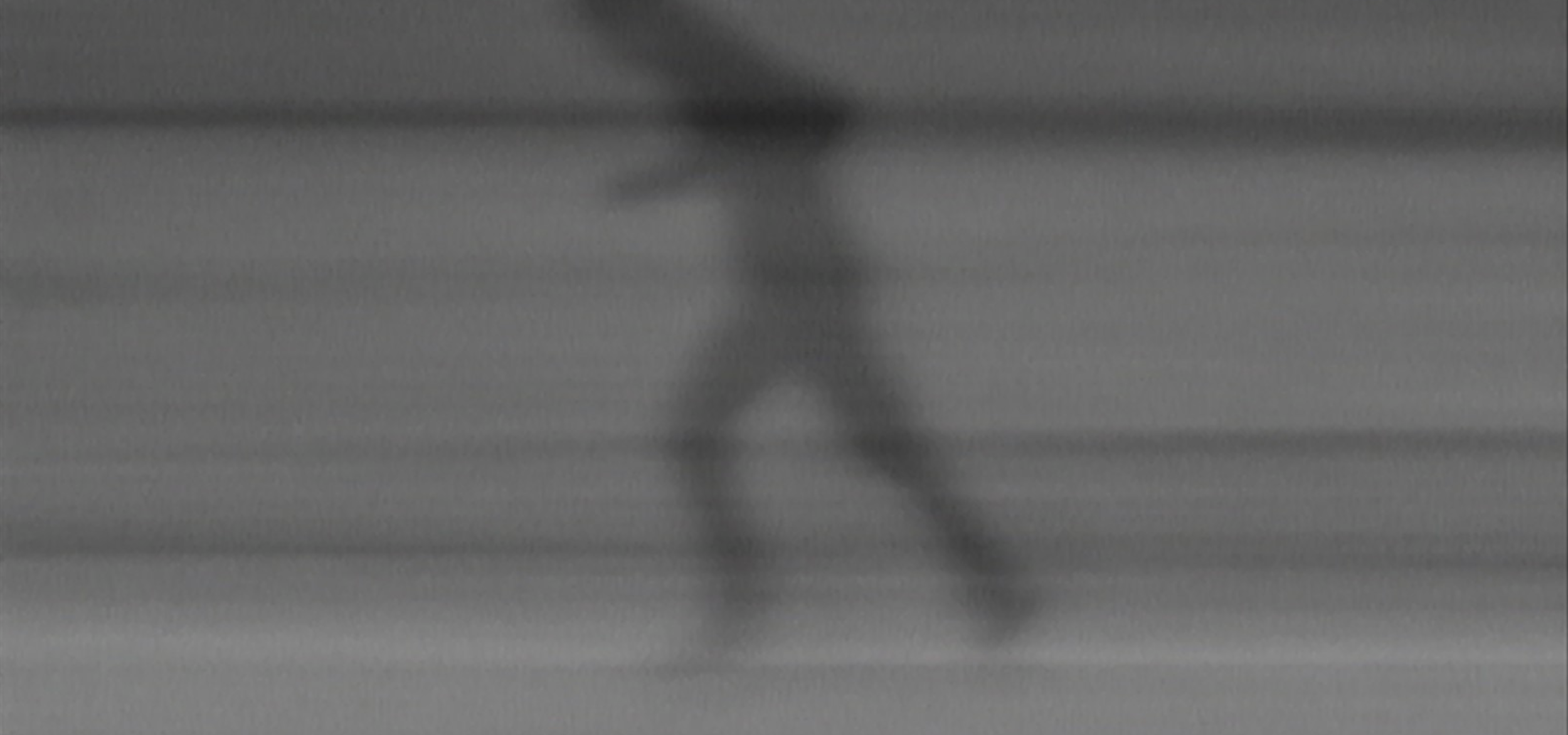
rew/ff — Altérer les écologies urbaines
Altérer les écologies urbaines a été commissarié par Ylenia Olibet dans le cadre de rew/ff, la résidence de recherche et de création pour commissaires émergent·es de Vidéographe. Ce programme de résidence vise à aider les commissaires en début de carrière à développer un nouveau projet et, ainsi, à acquérir de nouvelles compétences et connaissances qui enrichiront leur démarche.
Ylenia Olibet est une chercheuse et enseignante basée à Montréal depuis 2016, actuellement stagiaire postdoctorale à l’Université McGill. Sa recherche interroge la manière dont l’archive audiovisuelle inspire les mouvements sociaux. Sa démarche met à l’avant des perspectives transnationales et décoloniales ainsi que les approches féministes et queer appliquées à la culture cinématographique dans la francophonie.
Liste des œuvres au programme
Le tissu social montréalais se révèle plus que jamais sous tension. À l’été 2025, un projet de règlement sur les plaintes liées au bruit – depuis écarté – menaçait d’imposer de sévères restrictions à la vie culturelle populaire. Les vagues de chaleur estivales exacerbent les inégalités sociales déjà existantes, et des infrastructures non sécuritaires aggravent les conditions du milieu urbain. La crise du logement, quant à elle, mine progressivement la possibilité, pour une vaste portion de la population, de vivre dans la dignité. Pourtant, face à ces crises et en leur sein, Montréal a été témoin de puissantes formes de réponses collectives : la mobilisation publique contre les restrictions sur le bruit (juillet 2025), les manifestations pro-palestiniennes des deux dernières années, et l’initiative communautaire Wild Pride (août 2025), qui résiste à l’appropriation commerciale de la fierté queer. Ces pratiques de contestation des politiques, d’occupation de l’espace public et de redéfinition de ses significations révèlent Montréal/Tiohtià:ke comme un lieu où les communautés remettent à l’avant-plan la lutte et la solidarité en réponse à l’atomisation de l’individualisme néolibéral, et où peut s’ouvrir un espace pour confronter les récits coloniaux de peuplement.
Dans ce contexte, que peut nous enseigner la collection de Vidéographe sur les actes de défiance en regard des modèles hiérarchiques du design urbain, et sur la réélaboration des dynamiques urbaines? L’histoire de Vidéographe est intrinsèquement liée à celle de Montréal/Tiohtià:ke. Dès ses débuts, les préoccupations urbaines « locales » y étaient centrales : certaines des premières vidéos de la collection documentent des mouvements sociaux enracinés dans des luttes citadines et contestent directement l’organisation spatiale de Montréal. Inspiré par ces expérimentations de lutte collective et par l’appel à l’action de ces premiers documentaires, le geste curatorial qui sous-tend cette sélection de vidéos vise à réanimer le potentiel d’habiter la ville autrement.
En refusant une compréhension normative de l’urbanité, ce programme présente Montréal/Tiohtià:ke comme une ville interculturelle, façonnée par des gestes performatifs et des pratiques socioculturelles et politiques qui perturbent les flux hiérarchiques et linéaires de la planification urbaine et de la gouvernance. Par des stratégies de défamiliarisation de l’espace, des référents architectoniques, des usages et représentations des infrastructures, des déchets, ainsi que par des récits de contestation, les œuvres de ce programme visent ensemble à « désessentialiser » les constructions narratives identitaires de la métropole. En résistant aux cadrages nationalistes, le programme attire l’attention sur Montréal/Tiohtià:ke comme espace transnational, à travers des incarnations communautaires situées. Plutôt que de placer l’identité au seuil de toute approche, il cherche à mettre en lumière la différence et la multiplicité des approches et des activités urbaines médiatisées qui émergent de la ville. À partir de ce cadre, le programme reflète aussi les limites de la collection de Vidéographe, notamment l’absence manifeste de perspectives autochtones qui aborderaient les déplacements coloniaux des Premières Nations.
Bien que, sur le plan sonore, le programme ne semble pas défier ouvertement les conceptions conventionnelles de Montréal définies par le bilinguisme anglais-français, il tente toutefois de pointer vers le multilinguisme qui caractérise davantage l’expérience quotidienne de la ville, en rassemblant des approches diverses de la création d’images filmiques, de la manipulation physique de la pellicule aux essais vidéographiques, en passant par la performance, le documentaire ou la fiction expérimentale. Les vidéos de ce programme privilégient une immersion sensorielle avec la ville qui décentre le sujet moderne privilégié et ses flâneries. Si la marche et l’errance demeurent des modes centraux d’entrée en relation avec l’espace urbain, l’accent se déplace de la primauté de la vision vers les incarnations, la force affective de la mémoire, et parfois même l’optique posthumaine qui caractérise le lien avec la ville. Dans ce programme, le son contribue à une immersion urbaine incarnée et sensorielle, suscitant des formes d’accord avec l’environnement et cartographiant géographies industrielles, infrastructures, paysages sonores élémentaires, mouvements, engagement civique et courant fictionnel de conscience.
Les vidéos du programme ne se contentent pas de représenter Montréal/Tiohtià:ke; elles la mobilisent, et sont en retour mobilisées, pour parler de luttes sociales et environnementales, de nouvelles productions de l’espace et de façons imaginatives de vivre ensemble. Réunies, elles révèlent et interrogent les relations sociales, tout en articulant une compréhension écologique des interactions et coconstitutions, humaines et non humaines, dans l’environnement urbain.
Les infrastructures occupent une place prépondérante dans les trois premières vidéos du programme, invitant à poser un regard écocritique qui interrompt leurs significations et fonctions initiales. Dans Silos, la monumentalité statique du silo no 5 de Montréal/Tiohtià:ke se trouve transformée en film de danse. Tourné avec une caméra Super-8, le film est physiquement manipulé, fragmenté et retravaillé, de sorte que les images du silo dérivent à l’écran jusqu’à ce que le référent lui-même se dissolve en un espace hanté. Ce qui émerge est une atmosphère spectrale : la présence fantomatique de la structure, à la fois ruine industrielle obsolète et patrimoine urbain. Le silo devient ainsi une trace matérielle du passé de la ville, qui résiste autant aux récits fonctionnalistes qu’aux affects nostalgiques, tout en faisant écho aux préoccupations écologiques. Une atmosphère similaire imprègne Drift, bien que par d’autres techniques. Les manipulations temporelles de perspectives frontales et obliques sur les rues, les transports publics et les bâtiments suscitent un sentiment de désorientation, prélude à des séquences ralenties qui signalent des façons non normatives, non linéaires et disruptives d’habiter la ville. Dans KM 0, la désorientation naît de souvenirs fragmentés et d’expériences de déplacements et de voyages. En juxtaposant des images élémentaires de paysages variés, le film construit des géographies spatio-temporelles circulaires plutôt que linéaires. Ces enchaînements visuels associatifs refusent la dichotomie simpliste entre urbain et rural, convoquant plutôt des rencontres déclenchées par la mémoire, lesquelles témoignent de longues histoires de mouvements diasporiques et de relations incarnées avec l’environnement.
Les tactiques performatives de cartographie de l’espace et de contestation collective de ses usages se trouvent au cœur des deux vidéos suivantes, quoiqu’abordées de manières très différentes. Dans l’univers hyperstylisé aux teintes pastel de Jardins Paradise, l’inventivité presque absurde et l’obstination des membres de la diaspora arabe, qui transforment un stationnement en jardin, suggèrent des stratégies inventives de réappropriation de l’espace public face aux inégalités spatiales inscrites dans la vie urbaine – où le lieu de résidence détermine souvent l’accès aux services. Dans un registre tout autre, le documentaire militant La lutte des locataires propose un point de vue historique sur l’organisation des locataires en réponse à la crise du logement à Montréal/Tiohtià:ke, conséquence de la spéculation immobilière et de politiques municipales négligentes. Fidèle à la vocation du documentaire comme outil d’intervention sociale, la vidéo place au centre les voix et le vécu des habitant.es du quartier Saint-Louis, tandis que de larges panoramiques sur les toits et les rues enneigées, des travellings avant à travers le quartier, ainsi que de gros plans sur des affiches satiriques et des vignettes, offrent une résonance visuelle avec les luttes actuelles pour un logement abordable.
Passant de la tradition documentaire réaliste à la fiction expérimentale, la dernière vidéo du programme révèle des formes redistribuées d’agentivité, humaines et non humaines, qui façonnent les conditions matérielles de la vie urbaine. Dans Comme une ombre allongée sur l’asphalte, la rencontre avec des matelas abandonnés dans les rues de Montréal/Tiohtià:ke brouille la frontière entre le privé et le public, réinvestissant l’espace collectif d’une intimité nouvelle, tout en accordant une forme d’agentivité aux rebuts, qui deviennent participants actifs de la vie urbaine.











